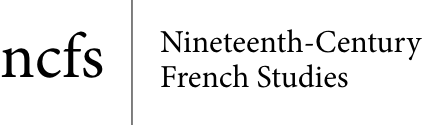Brossillon on Daouda (2020)
Daouda, Marie Kawthar. L’Anti-Salomé : Représentations de la féminité bienveillante au temps de la Décadence (1850-1910). Peter Lang, 2020, pp. 326, ISBN 978-1-78874-708-0.
Marie Kawthar Daouda prend le contre-pied des recherches sur la féminité dans la littérature décadente en se focalisant sur des exemples présentant une image positive de la femme, sélectionnés dans des textes français (en majeure partie) et britanniques de la deuxième moitié du XIXe siècle. Les exemples littéraires, connus et moins connus, sont mis en dialogue avec des références à la mythologie, à la Bible et à des figures historiques. Dans son essai, Daouda avance que la décadence est moins une tranche temporelle qu’un état d’esprit (5), avec un “intérêt croissant pour les marges, qu’elles soient sociales, sexuelles ou artistiques” (1). La décadence est l’histoire d’une fin imminente qui ne vient pourtant jamais. La ville moderne est telle Rome, au bord de la destruction, les femmes sont fatales, et les textes obsédés et hantés par Salomé que Gustave Flaubert installe en mythe fondateur dans Les trois contes. Salomé vient à incarner les angoisses de la mort qui symbolisent cette fin de siècle. En contraste, Daouda s’intéresse aux anti-Salomé, et montre une continuité historique avec les contes de fées et leurs princesses, figures féminines ressemblant au Christ de par leur bienveillance sacrificielle. Les figures de la féminité bienveillante qui sont étudiées par Marie Daouda sont la vierge Marie de Nazareth, Ève, Lilith, Jeanne d’Arc, et Marie-Madeleine.
L’Antiquité et le christianisme influencent cette image de la femme bienveillante sacrificielle. Dans un premier chapitre, Daouda se concentre ainsi sur le modèle marial de Marie de Nazareth, la première femme qui émule le Christ et dont la bienveillance est perçue comme un acte héroïque. Daouda passe en revue différents exemples de ce modèle d’une féminité mariale qui offre un contrebalancement à la décadence de la société fin-de-siècle en littérature, chez John Henry Newman, Marie Corelli, Jules Lemaître, Jean Bertheroy, Renée Vivien, Camille Lemonnier, Catulle Mendès et Jean Lorrain. Daouda s’intéresse également au personnage de Denise Baudu dans Au Bonheur des dames, qui représente “une sainteté laïque, féminine régénérante” (49) par sa bienveillance en rendant une voix et une force aux opprimés. La vierge s’attache à suivre les huit vertus mariales, similaires aux huit béatitudes exprimées dans “Le Sermon sur la montagne,” qui assurent la félicité de la femme et par extension de l’humanité. Cette figure féminine, unissant la beauté et la bonté à l’opposé de Salomé, serait Ève qui rétablit l’ordre après la chute dans un acte de rédemption.
Dans le deuxième chapitre, Daouda s’intéresse à cette Ève pénitente, victime, mais aussi mère de l’humanité donc porteuse de vie. La sexualité qui mène à l’enfantement n’est pas perçue comme un péché mais au contraire comme un acte positif. Le personnage de Lilith, associé à la séduction, incarne quant à lui le désir des décadents de réécrire la genèse du monde puisqu’elle tend à être associée à l’ésotérisme de la fin du siècle, à la fois mythe et figure biblique. Dans ce chapitre, Daouda fait référence aux tableaux de Dante Gabriel Rossetti qui inspirent notamment Marie Corelli et Marcel Schwob, deux auteurs qui s’intéressent à la spiritualité de Lilith par opposition à la matérialité d’Ève. Dans leur réinterprétation du mythe, Lilith est une muse bienveillante, “une martyre et une sainte” (116). Chez Rossetti, elle s’est incarnée dans le serpent pour tromper Ève. Chez Corelli et Schwob, elle est immatérielle et idéale donc éternité, mais aussi espoir, alors qu’Ève et ses descendants sont voués à la mort.
Le mythe originel de l’androgyne selon Platon est le mythe de référence pour l’analyse des exemples littéraires du troisième chapitre. Ce mythe de “l’inversion du masculin en féminin et du féminin en masculin est signe de décadence,” selon Vladimir Jankélévitch (117). Daouda voit dans ce personnage androgyne une image bienveillante et non une menace pour l’ordre social en ce qu’il incarne le désir d’absolu et d’idéal. Dans ce chapitre, elle s’intéresse également au personnage de la lesbienne fin-de-siècle qu’elle considère comme la parèdre du dandy, une sorte d’âme sœur qui rejette également la maternité et la matérialité. Elle cite notamment Baudelaire, et Renée Vivien et Liane de Pougy qui sont les héritières littéraires de ce dernier. Elle observe qu’il existe “un langage collectif réunissant poétesses saphiques et poètes orphiques, qui récuse l’ordre naturel et l’ordre social, et a recours aux mêmes images pour exprimer le même désenchantement et la même soif d’absolu” (141). De la lesbienne, elle glisse au personnage de la religieuse pour qui l’important est l’anéantissement de soi, devenant ainsi une victime propitiatoire dans un élan de charité sacrificielle pour l’avènement d’une nouvelle ère lavée de corruption.
Le quatrième chapitre s’articule autour de deux figures centrales : Jeanne d’Arc et Marie-Madeleine, deux femmes représentant “une sainteté disruptive” (161). Jeanne d’Arc “est double. Femme et soldat, inspirée et hérétique, sainte et sorcière, elle est à la charnière entre codes de la légitimité féminine et masculine, entre bienveillance et héroïsme ; et elle constitue une figure d’androgyne chimérique à mi-chemin entre l’ange exterminateur comme grande synthèse et la vierge et martyre comme figure licite de la devotio féminine” (162). Jeanne d’Arc a quelque chose de hors du commun donc monstrueux. Pour Michelet, elle est une sorte de fée sauveuse de la patrie en pleine décadence, Huysmans fait d’elle une sainte chimérique mais aussi hystérique, tandis que Léon Bloy la présente en chef de guerre, tel Napoléon. Également vierge et ange, elle est comparée au Christ chez Michelet et Bloy. Marie Daouda analyse ensuite les représentations littéraires de Marie-Madeleine, pendant positif à Salomé car elle est la figure du repentir, “du passage de l’état de péché à l’état de grâce” (189). La prostituée devient héroïne sacrificielle chez Balzac, Hugo ou encore Dumas fils. Daouda utilise le personnage d’Esther de Balzac dans Splendeurs et Misères des courtisanes comme exemple de la courtisane qui se sacrifie par amour et se rachète en passant d’un amour terrestre à un amour divin, acte qui passe nécessairement par un renoncement à soi, par la perte de la beauté et de la santé.
Le volume se conclut sur un chapitre consacré à la chair de la femme bienveillante, moins désirée que suppliciée, comme une “crucifixion au féminin” (221). Le roman antiquisant de la deuxième moitié du siècle ne cache plus les corps ; les femmes sont mises à nu, leur corps est torturé par des sévices à caractère sexuel notamment, leur permettant d’atteindre une sorte de sanctification similaire à la souffrance christique, les auteurs naviguant ainsi sur la frontière étroite entre le pastiche et le blasphème. La martyre, réifiée, devient objet d’art. Daouda ferme son chapitre sur l’image de Salomé décapitée qui, selon elle, est “la plus efficace des anti-Salomé” (256). Elle étudie l’étrangeté de la danseuse, celle chez qui l’androgynie, l’animalité et la féminité sont exacerbées. Elle voit la danseuse comme la parèdre du poète, une artiste qui transforme son corps et sa danse en œuvre d’art, en quelque chose de divin. Salomé atteint la rédemption quand sa propre tête est coupée, devenant ainsi une sorte d’Orphée féminin. Au travers de cette décollation féminine, “la martyre est d’autant plus spirituelle qu’elle est réduite, par le supplice, au seul siège de la pensée” (291). Cette femme sacrificielle inspire désormais l’espoir.
Daouda a su trouver un grand nombre d’exemples de personnages incarnant l’anti-Salomé, tout en admettant que ceux-ci ne sont que des exceptions face au personnage de Salomé qui, lui, domine cette fin de siècle. Il est indéniable que Daouda possède également une profonde connaissance de la religion. Elle est clairement passionnée et convaincue par son sujet, même si l’image prégnante de Salomé semble rester encore çà et là au travers de certains personnages présentés comme anti-saloméens. Malgré les nombreuses coquilles et l’écriture souvent jargonneuse rendant la lecture parfois opaque, il n’en reste pas moins que, il n’en reste pas moins que L’Anti-Salomé : Représentations de la féminité bienveillante au temps de la Décadence (1850-1910) représente un travail colossal et innovant, permettant de nuancer les nombreux travaux qui présentent les femmes comme nécessairement funestes dans la littérature décadente.