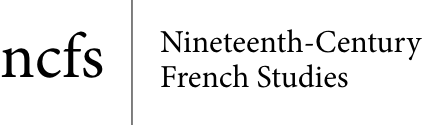Ifri on McGuinness (2024)
McGuinness, Max. Hustlers in the Ivory Tower: Press and Modernism from Mallarmé to Proust. Liverpool UP, 2024. pp, x + 326, ISBN: 978-1-80207-473-4
De Balzac à Proust, les rapports des écrivains avec la presse ont toujours été ambigus. Le fait que le premier n’avait pas de mots assez forts pour la critiquer, notamment dans Illusions perdues, ne l’a pas empêché d’écrire de nombreux articles et de publier initialement un grand nombre de ses ouvrages en romans-feuilletons. Cette ambiguïté, qui se retrouve chez Baudelaire, Maupassant et Flaubert, caractérise également l’attitude des trois auteurs auxquels Hustlers in the Ivory Tower est principalement consacré: Mallarmé, Apollinaire et Proust. Pour ces écrivains, en effet, la presse, qui se développe à une vitesse considérable sous la Troisième République, symbolise une modernité qu’ils rejettent et adoptent tout à la fois. S’ils sont des “hustlers” dans leur tour d’ivoire, c’est qu’ils partagent la même haute idée de la littérature tout en utilisant les outils de la modernité et notamment la presse pour expérimenter, exposer leurs idées et se faire connaître. C’est ce que montre brillamment cet ouvrage qui est une version remaniée d’une thèse de doctorat.
Hustlers in the Ivory Tower comprend cinq chapitres. Dans le premier Max McGuinness se concentre sur le rapport particulier que Mallarmé entretenait avec la presse. Si, comme la plupart de ses confrères, le poète considère avec inquiétude l’importance croissante que prend le reportage dans les journaux, ce qui laisse de moins en moins de place aux textes littéraires et notamment à la poésie, sa position est beaucoup plus nuancée. En même temps, en effet, la presse se situe au cœur de la révolution poétique à laquelle il aspire. S’en servant comme ce que l’auteur appelle un “laboratoire littéraire,” il imagine un nouveau genre poétique, le “poème critique,” qui marierait littérature et journalisme. La frontière entre ces deux domaines devient alors pour lui si floue qu’il rêve d’une sorte de synthèse entre livre et journal, qu’il nomme “le Livre,” et que son fameux poème Un coup de dés jamais n’abolira le hasard est une œuvre dont la présentation et la forme s’inspirent de la typographie de presse et qui laisse entrevoir ce qu’aurait été “le Livre.”
Les deux chapitres suivants portent sur les “petites revues,” comme La Revue blanche et Mercure de France, qui, constituant une sorte de trait d’union entre littérature et journalisme, sont alors utilisées par de nombreux écrivains comme des “laboratoires littéraires.” Bien que ces revues s’opposent à la grande presse, qui, selon elles, ignore les idées nouvelles et est esclave de l’actualité, et qu’elles la satirisent fréquemment, la distinction entre les deux types de publication n’est pas toujours claire puisque les petites revues, qui ont besoin de la publicité apportée par les grands journaux, offrent également des reportages et que de nombreux auteurs ont “un pied dans les deux camps.” La frontière entre littérature et journalisme dans ces petites revues est d’autant plus ténue que nombre d’écrivains qui s’en sont servis comme “laboratoire littéraire” s’inspiraient souvent des faits divers et de l’actualité, créant ainsi des œuvres que McGuinness nomme “literary actualité.” Parmi ceux qui s’adonnaient à cette pratique il s’attarde sur Mallarmé et ses poèmes critiques, Charles-Louis Philippe et ses Faits divers, Alfred Jarry et ses Spéculations et Gestes et même son Ubu roi, ainsi que Félix Fénéon et ses “Nouvelles en trois lignes.” De même, maints écrits de Charles Péguy et des passages de romans comme Le Journal d’une femme de chambre d’Octave Mirbeau, Le Roi fou de Gustave Kahn et Jean-Christophe de Romain Rolland, d’abord publiés dans ces revues, font référence à des événements d’actualité comme l’Affaire Dreyfus et la menace de guerre. Au nombre des revues citées par McGuinness figure La Nouvelle Revue française qui a publié de nombreux textes liés à l’actualité, signés notamment Martin du Gard, Gide et surtout Proust dont l’idéologie telle qu’elle apparaît dans son roman fait souvent écho à celle reflétée dans La NRF.
Le quatrième chapitre s’intéresse principalement à Apollinaire et aux petites et grandes revues auxquelles il a collaboré, notamment Les Soirées de Paris, revue qui a aussi été pour lui une sorte de “laboratoire littéraire.” Chez lui, le lien entre presse et littérature est d’autant plus fort qu’il était également journaliste, un journaliste qui avait toutefois une piètre idée de sa profession. Ses textes en prose aussi bien que ses poèmes et ses “calligrammes” s’inspirent en effet souvent de la grande presse, y compris de ses propres articles, auxquels ils empruntent ses sujets et son iconographie. Par ailleurs, Apollinaire expérimente un type de poésie-reportage, particulièrement dans ses poèmes de guerre, qui n’est pas sans rappeler “le Livre” dont rêvait Mallarmé. Dans ce chapitre, McGuinness s’arrête également sur les écrits de Blaise Cendrars, d’André Salmon et de Max Jacob qui reflètent ce même désir de fusionner poésie et reportage.
Dans son dernier chapitre, McGuinness discute le rôle joué par la presse dans les discussions sur la soi-disant crise du roman qui ont tant alimenté les débats pendant cette période. Si la responsabilité de la presse dans cette crise est souvent dénoncée, il remarque que certains écrivains, bien que méfiants ou hostiles envers elle, lui sont certainement redevables, dans la mesure où elle occupe une place cruciale dans certains de leurs romans—c’est le cas de Gide—ou encore parce qu’elle leur a servi, à eux aussi, de laboratoire, comme dans le cas de Proust. En outre, dans le roman de ce dernier, bien que le journalisme soit souvent présenté de façon négative, il n’en est pas moins omniprésent et joue même un rôle-clé dans la naissance de la vocation du héros-narrateur, au point que McGuinness découvre des affinités entre la Recherche et “le Livre” de Mallarmé.
Cet ouvrage, remarquablement documenté et agrémenté d’une quinzaine d’illustrations, offre donc un tour complet des rapports complexes qu’ont entretenus la presse et la littérature à l’époque où celle-ci entrait dans l’ère moderne.